
Rencontres de Sophie 2009
E comme Euthanasie
Réflexions sur l’euthanasie avec Jacques Ricot, philosophe
Comment bien mourir ? Peut-on choisir sa mort ? La question de l’euthanasie se pose à nos sociétés contemporaines éprises de liberté de façon de plus en plus aigüe. La notion a une histoire ancienne mais a pris un sens bien particulier aujourd’hui, ce qui ne va pas sans poser de délicats problèmes éthiques.
Face à un sujet d’actualité qui suscite effroi et fascination, la philosophie permet dans un premier temps l’exercice salutaire de la “clarification sémantique”, une “démarche éthique” que le philosophe J. Ricot a proposé au public des Rencontres de Sophie. Avant de prendre position pour ou contre l’euthanasie, il s’agit donc de savoir exactement ce que le terme recouvre. Différentes significations lui ont été attribuées au cours de l’histoire tandis que l’usage contemporain entraîne un changement de sens important, en faisant intervenir un tiers qui vient mettre fin aux souffrances d’un malade.
l’euthanasie envisagée comme homicide change la nature de celle-ci et met fin à la définition héritée de l’histoire
Petite histoire du mot euthanasie
Euthanasie vient du grec et signifie littéralement : bonne mort. Dans l’usage grec puis latin du terme, il s’agit d’une mort douce, apaisée, voire glorieuse. Ainsi, lorsque l’historien latin Suétone fait usage du terme dans son récit de la mort de l’empereur Auguste (dans Vie d’Auguste), il désigne le fait de mourir dans les bras de la femme aimée, sans trop de douleur et rapidement. En aucune façon, il n’est fait référence à l’intervention d’un tiers, et il ne s’agit pas non plus d’un suicide, souligne J. Ricot. On retrouve ensuite la notion d’euthanasie au 17ème siècle chez le philosophe Francis Bacon par exemple, qui évoque le fait de mourir quand le moment est venu et souligne le rôle du médecin devant procurer au malade en phase terminale une mort douce. Le sens évoqué ici est donc celui du soulagement de la douleur par des soins médicaux, aujourd’hui appelés soins palliatifs.
C’est seulement à la fin du 19ème siècle qu’un changement important apparaît et que l’euthanasie prend une nouvelle signification. L’objectif reste la mort douce du malade mais on introduit un nouveau moyen pour y parvenir : la suppression de la vie par autrui. Pour J. Ricot, il s’agit de la “suppression du souffrant plutôt que de la souffrance” ou en d’autres termes d’une nouvelle catégorie d’homicide : “l’homicide par compassion”
Une clarification nécessaire
Sous la notion d’euthanasie vont donc cohabiter jusqu’à récemment deux significations, pouvant entraîner une confusion risquée. Celle des soins qui visent à adoucir la mort et celle de la suppression de la vie du malade par autrui dans le but de soulager sa souffrance. Cette dernière situation a pu aussi être qualifiée d’euthanasie active par rapport à une euthanasie dite passive. On a pu parler également d’euthanasie directe quand un traitement est administré qui écourte la vie du malade, en opposition à une euthanasie indirecte lorsqu’il y a arrêt ou omission de traitement.
Pour J. Ricot cependant, l’intervention d’un tiers c’est-à-dire l’euthanasie envisagée comme homicide change la nature de celle-ci et met fin à la définition héritée de l’histoire. Le sens contemporain de l’euthanasie comporte l’idée d’une volonté, d’un geste intentionnel, aussi bien du côté du malade que de celui qui la pratique, qui rend “inaudible” les notions d’euthanasie passive ou indirecte. Dans ce cas, l’euthanasie peut être un acte ou une omission d’acte : quand l’arrêt du traitement entraîne la mort du patient.
L’interdit du meurtre peut-il connaître des transgressions au nom de la compassion, face à celui qui estime librement que sa vie n’est plus digne d’être vécue ?
La définition de l’euthanasie proposée par J. Ricot est la suivante : “L’euthanasie consiste dans le fait de donner sciemment et volontairement la mort ; est euthanasique le geste ou l’omission qui provoque délibérément la mort du patient dans le but de mettre fin à ses souffrances”.
Questions éthiques
Souvent défendue au nom du droit à mourir dans la digité, l’euthanasie pose à la société toute entière plusieurs questions, résumées ainsi par le philosophe : l’interdit du meurtre peut-il connaître des transgressions au nom de la compassion, face à celui qui estime librement que sa vie n’est plus digne d’être vécue ?
Qu’entend-on par dignité ? Les défenseurs de l’euthanasie demandent à pouvoir mettre fin à leur jour à l’aide d’un tiers quand leur dignité leur semble fortement remise en cause par le vieillissement ou la maladie. La dignité est ici perçue comme une notion subjective qui s’apparente à l’estime de soi. A cette définition, J. Ricot oppose la notion de dignité ontologique, celle que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 reconnaît comme qualité intrinsèque de l’être humain. Cette dignité est intangible, elle n’est pas remise en cause par la maladie ou la dégradation du corps, elle est aussi indépendante du regard que l’autre porte sur nous.
Plus essentiel encore, l’euthanasie remet en question l’interdit de tuer qui est à la base de la plupart des sociétés humaines. Principe fondamental mais pas absolu, il comporte déjà quatre exceptions dans le droit français : la guerre, la légitime défense, le suicide, l’avortement. La légalisation de l’euthanasie pose donc pour l’ensemble du corps social la question de l’affaiblissement de cet interdit, au nom de la compassion pour les souffrances d’autrui.
Emilie Le Moal
Photos : Aurèle Hardouin
Pour en savoir plus
Le programme des Rencontres de Sophie
Philosophie et euthanasie par Jacques Ricot
Tous les articles des Rencontres de Sophie Vivre et Mourir
 Relations entre la vie et la mort. Difficultés, hypothèses et enjeux
Relations entre la vie et la mort. Difficultés, hypothèses et enjeux
Conférence de Frédéric Worms, philosophe
 Vieillir et mourir, est-ce bien naturel ?
Vieillir et mourir, est-ce bien naturel ?
Interview vidéo de André Klarsfled, biologiste
 Fin des âges ou lutte des âges
Fin des âges ou lutte des âges
Conférence de Pierre-Henri Tavoillot, philosophe
Interview de Cécile Défaut, éditrice de philosophie
Les éditions précédentes des Rencontres de Sophie
 2007 Le Bien et le Mal
2007 Le Bien et le Mal
Tous les articles de l’éditions 2007 Le Bien et le Mal
 2008 Images
2008 Images
Tous les articles de l’éditions 2008 Images
Même auteur
-
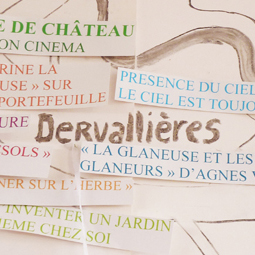
La Fabrique Dervallières : premier maillon d’un réseau de laboratoires artistiques à Nantes (2/3)
-
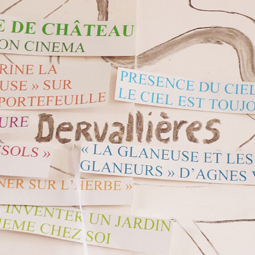
La Fabrique Dervallières : premier maillon d’un réseau de laboratoires artistiques à Nantes (1/3)
-

Le cinéma comme acte révolutionnaire
-

La philosophie de l’édition
-

Fin des âges ou lutte des âges ?
-

E comme Euthanasie
Bloc-Notes
-
«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013
-
Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers
-
La 7ème Vague ouvre le bal des festivals
-
Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois
-
Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses


 Le dernier numéro
Le dernier numéro



 Haut de la page
Haut de la page

