
Rencontre avec La Luna et Arlène
Modeler la terre de Sejnane à plusieurs mains 1/2
« L’œuvre créée est tout aussi importante que l’énergie collective.  » C’est de cette conviction qu’est né le projet Laaroussa, « action artistique communautaire  » entre le collectif Tunisois Dream City, les associations La Luna, Arlène (Bellevue) et soixante femmes potières de Sejnane (nord de la Tunisie). Après six mois d’immersion à Sejnane, Anne (La Luna) et Khaddouma (Arlène) reviennent sur leur expérience et racontent comment le collectif devient le matériau de base de la création grâce aux échanges des savoir-faire de chacun.
« Laaroussa » sonne comme un nom de cité imaginaire. Signifiant à la fois « poupée » et « mariage », le terme pourrait renvoyer aussi à ce lieu rêvé. Car tel est l’objectif du projet Laaroussa qui s’est déroulé de février 2011 à juin 2011 dans la région de Sejnane au nord de la Tunisie. En créant un collectif d’une centaine de personnes, Laaroussa a voulu marier les savoir-faire artisanaux des femmes de Sejnane à l’art contemporain des artistes plasticiens, danseurs, musiciens autour d’un objet symbolique : la poupée en terre cuite.
Anne de La Luna et Khaddouma d’Arlène retracent leurs aventures sur la terre brute et fragile de Sejnane.
Entre la terre cuite et le jasmin
Fragil : Pouvez-vous nous parler des origines du projet. Comment l’avez-vous rejoint ?
Anne : Laaroussa est un collectif d’une centaine de personnes qui rassemble soixante femmes potières de Sejnane (nord de Tunisie), une vingtaine de personnes du collectif Dream City, Pascale, Anne-Françoise, Zozane, Fatima et Khaddouma de l’association Arlène et Marie, Laure et moi-même de La Luna.
Le projet part d’une rencontre avec le collectif Tunisois Dream City. Créé en 2007, il rassemble des plasticiens, des graphistes, des musiciens, des danseurs, des chorégraphes dont Sofiane et Selma Ouissi font partie. Ce sont ces frère et sœur qui sont à l’initiative du projet. Marie de La Luna a une amie qui s’est installée à Tunis et qui fait partie de ce collectif. Depuis 2007 Dream City a créé à Tunis un évènement artistique sur l’espace public, un peu l’équivalent des Allumés à Nantes. Le but est de révéler des lieux de la vieille ville de la Medina de Tunis grâce à l’art. C’est une manière de rapprocher les publics et la culture tout en encourageant la création. La Medina se transforme aussi en lieu de débat. En octobre 2010 pour la deuxième édition du festival, Dream City a convié La Luna. Marie est donc partie en émissaire pour assister à des débats sur l’art public, mais également témoigner sur notre façon de faire dans les quartiers populaires et sur notre idée du collectif. La rencontre avec Selma et Sofiane a été forte. Un mois après, Selma nous contacte pour nous proposer un projet autour du savoir-faire des femmes de Sejnane. Sofiane vit à Tunis mais Selma réside entre Paris et Tunis. Un jour, dans une galerie de la capitale française, elle tombe sur une poupée en argile de Sejnane qui est vendue hors de prix. Elle connaît la région, elle sait que les femmes qui fabriquent ces poupées vivent dans des conditions très précaires. Elle se dit alors qu’ « il y a un truc à imaginer ». Par un savoir-faire collectif, elle voudrait regrouper les femmes de Sejnane pour leur permettre de continuer à pratiquer leur artisanat dans un environnement plus digne en relation avec d’autres artistes dans un échange artistique et citoyen. Sachant notre expérience de savoir-faire à Nantes avec les actions collectives que nous menons entre autres avec Arlène et d’autres associations autour du textile, du bois, de l’écriture, de la danse et de la musique, elle a tout de suite pensé à nous pour le projet Laaroussa. Il était évident pour nous que ça ne pouvait se faire qu’en embarquant les personnes qui nous accompagnent sur nos projets. Ça ne prenait sens que comme ça.
Comment vous êtes-vous rencontrées Arlène et La Luna ?
Anne : Cela fait quinze ans que La Luna et Arlène [1] travaillent ensemble avec l’Atelier Bricolage des Dervallières sur une idée de transversalité. A l’époque nous organisions des expos ventes avec des commandes de mobilier pour les collectivités. La Luna travaillait le côté pictural avec les gens de l’Atelier Bricolage et Arlène, toute la partie textile. Le fait déjà, que La Luna a toujours travaillé à trois, élargit les perspectives de projets. Plusieurs années après, le réseau inter-quartier naît entre Bellevue et les Dervallières entre autres, et plusieurs associations le rejoignent. Nous voulions aller plus loin et rendre compte concrètement de tous nos croisements. De là sont nées les actions collectives en 2005 avec l’organisation Le Faire savoir [2] dont fait partie Khaddouma. Se joignent plusieurs autres associations : La Luna, Arlène, mais aussi L’Atelier Bricolage (Les Dervallières), L’Atelier Look (Les Dervallières), Atao (centre ville), Le Cube (Quartier Nord La Boissière), Le Dernier spectateur (Les Dervallières), Kalz a Dud et La Conserverie. Ainsi les gens d’Atao allaient travailler à l’Atelier Bricolage et vice versa. Il y avait un véritable échange de savoir-faire. Par exemple, Kaddhouma est partie faire des ateliers couture à Arlène puis a fait de la danse à La Conserverie. Le but de ces actions est d’offrir un lieu de rencontre, d’information, de conseils et d’échanges réciproques de savoirs, pour faciliter la mise en réseau des publics. Entre les gens qui participent et les encadrants, les rôles de chacun sont réajustés et déplacés. Quand on se retrouve à soixante personnes, on ne sait plus qui est qui. Le collectif prend vraiment sens ainsi. En s’inspirant de notre savoir-faire du collectif, Sofiane et Selma voulaient regrouper les potières de Sejnane.
Qui sont ces potières de Sejnane ?
Normalement dans la religion musulmane, la représentation humaine est prohibée et la représentation d'une poupée féminine encore plus. Cette pratique des femmes de Sejnane revêt donc un caractère symbolique de résistance
Anne : Sejnane est un petit village en hauteur au Nord de la Tunisie relié par une route qui mène à la côte. Tout au long de cette route, il y a des lieux-dits. La région de Sejnane s’étale sur une cinquantaine de kilomètres. Ce n’est pas une région touristique, elle est assez pauvre. Les femmes vivent de la vente de poupées en terre cuite. La pratique de la poterie est ancestrale et vient de la tradition berbère. Mais la fabrication des poupées elle, n’a qu’une soixantaine d’années. Elle est née d’une femme de la région en mal d’enfant qui a commencé à faire des poupées. Normalement dans la religion musulmane, la représentation humaine est prohibée et la représentation d’une poupée féminine encore plus. Ce n’est que lorsque la poupée « Laaroussa » est mariée et brûlée, qu’elle est acceptée et peut être vendue.
Les enfants jouent avec des poupées masculines. Cette pratique des femmes de Sejnane revêt donc un caractère symbolique de résistance. Les femmes avant cela, vendaient diverses choses pour survivre au bord de la route. Cette femme en mal d’enfant s’est mise à vendre ses poupées à côté de des autres femmes et vendait plus qu’elles. On ne sait pas qui exactement les lui achetait mais sa marchandise surprenait d’avantage. Cette pratique s’est sue petit à petit. Les maris ont accepté ce commerce car cela faisait vivre leur famille. C’est ainsi qu’une autre économie s’est créée sur le territoire. Cette femme n’a pas à proprement parler transmis son savoir mais elle a semé une graine. D’un endroit à l’autre, les poupées sont différentes mais on retrouve des similitudes dans la technique car le lien avec la tradition berbère est fort. Les poupées sont peintes avec du lentisque qui est une plante locale et qui devient noire brillant à la flamme. Elles sont cuites avec de la bouse de vache, parfois vernies à la bave d’escargot. Les graphismes aussi remontent à un savoir ancestral présent au Maroc et en Algérie.
D’un point de vue personnel ou professionnel, connaissiez-vous la Tunisie et les poupées de Sejnane ?
Khaddouma : Pas du tout. Ça a été une véritable surprise.
Anne : Je n’avais jamais vu ces poupées mais je suis sensible à l’artisanat berbère car je suis souvent allée en Algérie. Laaroussa a été une réelle rencontre.
Revenons au projet. Combien de temps a duré la préparation ?
Anne : Dès novembre 2010, nous avons commencé à préparer le projet à distance. Dream City de son côté s’est mis à chercher des financements pour le projet. Les porteurs du projet se sont adressés à la fondation égyptienne Anna Lindh [3] sur les relations méditerranéennes, présente en Tunisie. Celle-ci a accepté de nous aider à hauteur de 20 000 euros. Beaucoup de choses se sont faites sur place avec les Tunisois présents sur le terrain. En hiver, ils ont repéré les lieux. Ils sont également rentrés en contact avec cinq femmes mises en avant par l’office de tourisme de Tunis pour leur savoir-faire de la terre. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes potières soient reconnues pour leur artisanat en Tunisie, il ne s’agit que de deux ou trois femmes alors qu’il y a toute une communauté. C’est pour cela que pour nous, le projet ne prenait sens que s’il mettait également en valeur l’économie du territoire et toutes les étapes de leur travail qui sont aussi importantes que la finalité. Pendant que des femmes vont chercher la terre et l’eau, d’autres cassent la pierre ou cuisent les poupées. Et pendant tout ça, qui s’occupent de leurs enfants ? Nous avons demandé au collectif Dream City d’avoir une vision plus large du projet Laaroussa. Grâce au financement, ils ont proposé de salarier au smic tunisien les femmes de Sejnane. Cela correspondait à soixante femmes que les Tunisois sont allés cherchés sur trente kilomètres. Les femmes qui ont rejoint le collectif ne se connaissaient donc pas toutes. En échange de leur salaire, elles allaient effectuer en communauté une des tâches de fabrication des poupées, mais aussi les autres tâches quotidiennes qui contribuent au vivre-ensemble : préparer le thé, les repas et la garde des enfants. Une autre femme était payée pour écrire sur l’expérience du projet. Mais aussi, elles allaient participer à plusieurs ateliers artistiques en compagnie des différents artistes du collectif Laaroussa. A terme, l’idée était de créer une coopérative pour les femmes potières de Sejnane qui rassemblerait différents ateliers : travail de la terre, cuisine, réfectoire, espace d’accueil pour les enfants, salle de classe pour l’alphabétisation et espace d’exposition. Décembre est arrivé et les premiers signes de la révolution tunisienne se sont faits sentir. On a eu peur que le projet ne se fasse pas. La fédération a accepté quand même de le financer [4] car pour elle, ça prenait tout son sens.
A terme, l'idée est de créer une coopérative pour les femmes potières de Sejnane qui rassemblerait différents ateliers : travail de la terre, cuisine, réfectoire, espace d'accueil pour les enfants, salle de classe pour l'alphabétisation et espace d'exposition
C’est vrai que le début du projet coïncide avec les premiers soubresauts de la révolution tunisienne. Était-ce volontaire ? Avez-vous vécu la révolution de près ?
Anne : Dream City n’a pas attendu la révolution pour faire bouger les choses. Déjà, lors des débats du festival Dream City en octobre 2010, le pays était en pleine émulsion. On sentait l’envie très forte de changement. La correspondance des dates n’est pas volontaire mais en même temps ce n’est pas un hasard. Les évènements nous ont toutes confortées dans l’idée de faire ce projet. Il y avait une attente si forte dans la région qu’on pensait que nous étions financés par la révolution. Les femmes nous attendaient de pied ferme. A Sejnane, on ne se rendait pas vraiment compte de la Révolution. Par contre à Tunis, il y avait le couvre-feu. Lors de nos déplacements entre Sejnane et Tunis, des louages [5] nous emmenaient. Le mari d’une des potières qui conduisait n’était pas rassuré. La nuit, je me souviens qu’on entendait les hélicoptères.
Les femmes de Sejnane sont pour la plupart analphabètes. Comment s’informent-elles ? Quel était leur regard sur la révolution ?
Anne : Elles ne sont pas toutes analphabètes et elles sont très bien informées. Elles ont des transistors, la télévision posée à même la terre quand il y a de l’électricité. Elles se rendent quelque fois dans le village de Sejnane ou à Tunis, l’information circule. La première semaine, nous avons demandé aux femmes de créer quelque chose en terre cuite et de nous dire ce que ça symbolisait pour elles. Tout ce qu’elles disaient avait attrait à la révolution. En général, elles sont très politisées. Des femmes soutenaient la révolution, d’autres lucides disaient que ça n’allait rien changer pour elles. En fait, elles s’inquiétaient plus de leurs problèmes immédiats. Elles n’ont pas l’eau courante et vont chercher l’eau au puits. Lorsque nous sommes venues pour la troisième fois, il y avait des problèmes d’eau. Quelques mois auparavant, une jeune fille s’était noyée dans le puits. Elles étaient en colère et se battaient auprès du Wilaya [6] qui leur avait promis que le nécessaire serait fait. Comme il n’y avait toujours rien, elles faisaient la grève et barraient la route. Elles ont fini par avoir gain de cause.
Comment ont-elles accueilli le projet Laaroussa ?
Anne : Beaucoup de femmes de Sejnane voulaient rejoindre le projet. Les maris nous demandaient pourquoi on ne prenaient pas leur épouse. Mais le projet avait un financement pour soixante femmes. On a même proposé à chacune des participantes d’enlever un dinar de leur salaire pour accueillir d’autres femmes. Évidemment, elles n’ont pas voulu et finalement les autres femmes étaient compréhensives. Forcément, le projet Laaroussa a été bien accueilli car au départ elles y voyaient surtout le côté rémunérateur. Mais ça a été pour elles aussi une véritable expérience de rencontres.
Et de réflexion...
Anne : Tout à fait. Les Tunisois de Dream City doutaient au départ de la capacité des femmes de Sejnane à porter le projet et à réfléchir sur leur avenir. Ce n’était pas notre vision. C’est pour cela que durant la première semaine de notre séjour fin février 2011, nous avons organisé des temps de débat, même si c’était en arabe et que l’on ne comprenait rien. Ces temps de débat ont été fondateurs. Les femmes ont compris qu’elles étaient payées pour se rencontrer, apprendre à travailler ensemble, à réfléchir sur leur avenir grâce à la création de la coopérative. Pour comprendre aussi comment elles se situaient dans leur environnement, on a demandé aux femmes de tracer sur le sol avec du charbon, une carte de leur espace. Ça a donné lieu à des échanges vifs puisque certaines femmes, plus reconnues que d’autres, se dessinaient une plus grosse maison. Ça a révélé les imaginaires de chacune, mais aussi de manière plus pragmatique les problèmes d’analphabétisme. Après ces échanges, on savait que notre prochaine venue serait accompagnée de celle d’Arlène et quel allait être son rôle. Comme il y avait la révolution, on ne voulait pas les convier tant que tout était incertain. On a préféré repérer les lieux, rencontrer les femmes et parler de la suite de l’aventure avec Dream City. Entre février et juin, La Luna est revenue trois fois en France, Arlène deux fois. Nos séjours à Sejnane duraient environ une semaine mais étaient très intenses.
Pétrir les rencontres
Comment s’est passée l’arrivée d’Arlène à Sejnane ?
Khaddouma : Au retour de La Luna en France, les filles nous ont présenté un morceau de carte des femmes de Sejnane qu’elles avaient reproduites. Nous avons alors commencé à travailler sur une cartographie en tissu de la région, même si on ne connaissait pas encore l’endroit. Ça a été le premier lien avec les potières. Pour nous, c’était très important de participer au projet. Même si ma fille était inquiète car c’était la révolution, je savais que j’étais avec des personnes de confiance. Nous sommes arrivées fin avril. Je me souviendrai toujours de la première question que les femmes m’ont posé : « vous êtes payées combien ? » Elles avaient du mal à croire que c’était un acte gratuit. Je leur ai expliqué que nous étions là pour les aider, discuter et échanger nos savoir-faire. Nous avons beaucoup parlé. Je parle arabe mais ce n’est pas le même dialecte. Je comprenais seulement quelques mots et parlais français avec certaines. Elles me posaient beaucoup de questions sur la France. Comment on vit ? Combien on gagne ? Est-ce qu’on est marié ? Est-ce qu’on a des enfants ? Je leur disais qu’en France, les gens n’avaient pas tous une maison et que les fins de mois étaient difficiles pour certains. Des femmes avaient dans l’idée d’immigrer en France, mais elles ne s’imaginaient pas que la vie n’était pas si simple. Elles vivaient dans leur bulle. Des potières n’avaient même jamais vu la mer alors qu’elles habitent à vingt kilomètres de la côte. Avec les femmes, nous avons continué la carte en tissu. La couture n’est pas du tout un savoir-faire qu’elles maîtrisent. Il y avait une petite fille qui n’avait jamais vu de fil et d’aiguille de sa vie. Dans le bourg de Sejnane d’ailleurs, c’était très difficile de s’en procurer. Les femmes étaient contentes d’apprendre. En échange, elles nous ont enseigné le savoir-faire des poupées.
Comment se passaient les journées ?
Anne : Au départ, les Tunisois pensaient que nous allions pouvoir loger chez les potières, mais elles vivaient de manière si rustique qu’il nous semblait impensable de le leur demander. Dream City avait donc loué une maison au bout des vingt kilomètres de Sejnane. On se rejoignait toutes le matin très tôt en général vers 7h30 et les potières étaient déjà là en train de casser la pierre. D’ailleurs, il y a une anecdote amusante. Un jour, nous étions bloquées à cause de la grève. Comme elles ont toutes un portable, elles nous avaient appelées pour nous dire de venir avant que la route ne soit barrée, vers 4h du matin. Pour elles, c’était normal. Les journées étaient toutes différentes en fonction des ateliers et de l’avancement des projets. Mais elles commençaient toujours par un travail du corps avec Selma en extérieur dans un abri précaire que nous avait prêté l’une des femmes. On était très nombreuses. Les enfants étaient là aussi et participaient à l’échauffement. Deux par deux, les femmes se caressaient le visage. C’est drôle car elles avaient la même gestuelle sur leur partenaire que sur leur poupée. C’était très sensuel. Ce sont des choses qu’elles n’ont jamais faites et pourtant elles se sont spontanément prêtées au jeu. Se regarder dans les yeux avec une femme qui habite à 10 kilomètres de chez soi, c’était fort.
Elles aimaient tellement ça, que l’échauffement prenait de plus en plus de place. Ensuite, elles se mettaient par groupe de quatre pour réaliser les tâches de la journée. Tout se passait dans le même lieu pour favoriser l’échange : crèche, repas, préparation du feu pour le thé... A l’extérieur, un groupe de femmes cassait les briques. D’autres mélangeaient les briques à la terre au tamis. Un groupe allait chercher la terre et l’eau, pendant que deux femmes commençaient déjà à monter la poupée. Nous aussi, on participait. Ça pouvait tourner mais des femmes se sont attribuées une des tâches durant tout le projet. Parfois on faisait cela sous forme de jeu, en se passant la terre chacune notre tour. Les femmes continuaient aussi leur vie quotidienne : traire les vaches tôt le matin et vendre leur lait avant de nous rejoindre. Le soir, elles allaient vendre leurs poupées. Elles avaient des doubles journées.
Ces femmes étaient-elles d’emblée ouvertes pour partager leur savoir-faire quitte à ce qu’il soit détourné ?
Anne : Les femmes de Sejnane aiment beaucoup partager leur expérience. Comme le but était de créer du collectif mettant en valeur les échanges et les savoirs techniques de chacun, chaque membre du collectif a fait des propositions. [7] Nous avons fait un travail filmique sur toutes les étapes de la fabrication de la poupée du début jusqu’à son mariage, avec un angle sur les sentiments des femmes pendant qu’elles créent leur poupée. L’atelier de travail s’est donc converti en studio. Nous avions tendu une grande bâche bleue pour pouvoir transformer l’image en arrière-plan. Comme les potières sont toujours habillées avec plein de couleurs, on leur avait dit de ne pas porter de bleu. Du coup, elles venaient vêtues de toute une composition de couleurs, c’était incroyable. Nous avons filmé pendant plusieurs jours. Les femmes venaient une par une refaire pendant quelques secondes une étape de la fabrication de la poupée. Elles se sont très bien prêtées au jeu. L’énergie de groupe était très forte. C’est ainsi qu’elles se sont rendues compte de l’importance de chaque étape. Notre projet de départ n’était pas forcément de produire quelque chose. Notre but était d’abord de créer du collectif avec les moyens que nous avions. Pour nous, pas besoin de magnifier ce que ces femmes savaient déjà faire. Sonia Kallel a eu envie de créer une grande robe en carreaux d’argile réalisés par les femmes, pour symboliser la communauté des potières. Cette robe allait vêtir une poupée en terre cuite de trois mètres. Une autre plasticienne Tobi Ayédadjou, originaire du Bénin qui vit à Tunis a fabriqué avec les femmes un collier en terre cuite. Les ateliers étaient mélangés, on s’aidait entre artistes. Tout le monde était content.
Notre but était d'abord de créer du collectif avec les moyens qu'on avait. Pour nous, pas besoin de magnifier ce que ces femmes savaient déjà faire
Quelle était la position de leur mari ou des hommes en général sur ce qu’elles faisaient ?
Anne : Nous avons eu très peu de contact avec les hommes. Ils vivent de la terre, mais à Sejnane, le sol est marécageux alors parfois ils travaillent plus loin, à Bizerte. Alors, ils sont absents pendant plusieurs semaines. D’autres femmes sont veuves. Certains maris présents, mais pas tous étaient fiers. Ils trouvaient par exemple que grâce aux exercices corporels, leur femme était mieux. A aucun moment les hommes se sont opposés au projet. Deux maris nous ont même prêté main forte à la fin du projet pour construire le « lieu rêvé ».
Propos recueillis par Pauline Vermeulen
Lire la suite de la rencontre avec les femmes de Sejnane ici.
[1] Créée en 1986, l’association Arlène propose à la base des activités de tricot, de couture et de repassage à des femmes allocataires du RMI pour les former et leur donner accès au marché du travail
[2] service crée par l’association CLCV (Consommation logement et cadre de vie) ; Le Faire Savoir est un lieu d’accueil et de convivialité sur le quartier de la Butte Sainte Anne pour le développement de liens sociaux et la mise en action collective
[3] Créée en 2005, la fondation contribue « au rapprochement des populations des deux côtés de la Méditerranée en vue d’améliorer le respect mutuel entre les cultures » en lançant et soutenant des actions ; aujourd’hui la fondation rassemble un réseau de plus de 3000 organisations dans la région méditerranéenne.
[4] D’autres organisations ont participé aux financements : la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, l’Institut Français de Coopération, l’Ambassade de Suisse, la ville de Nantes, Dorémail, Vision+, l’Association Muzaq, l’Art Rue, la Luna, Propaganda, S.P.I.B.A, le gouvernorat de Bizerte, la municipalité de Sejnane et les partenaires médias, Mille et 1 Tunisie, adc, Tuniscope.
[5] Taxis collectifs
[6] Préfet de la région
[7] Cinq workshop d’une semaine de création partagée avec différents artistes ont abouti à la fabrication d’une œuvre : 1.Vêtement-robe en carreaux-perforés sur une poupée-idole en terre cuite (Sonia Kallel). 2.Bijou-femme en perles de terre cuite grandeur nature en forme de bijou berbère et arbre métaphorique (Tobi Ayédadjou). 3.Œuvre expérimentale de musiques bebère et contemporaine (Saloua Ben Salah). 4.Film d’une chorégraphie sur le geste et le corps de la potière (Cécile Thuillier, journaliste avec les danseurs Selma et Sofiane). 5. Installation d’une carte en tissu et film sur la fabrication de la poupée par les associations nantaises La Luna et Arlène.
Bloc-Notes
-
«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013
-
Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers
-
La 7ème Vague ouvre le bal des festivals
-
Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois
-
Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses


 Le dernier numéro
Le dernier numéro
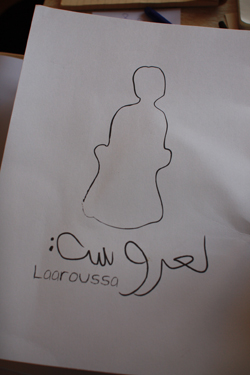






 Haut de la page
Haut de la page




