
Rencontres de Sophie 2008
La fin du monde dans un fauteuil de cinéma
"Images de la Catastrophe", Ollivier Pourriol, Lieu Unique, Nantes, 16 mars 2008
"Evitez d’être pris dans le champ d’une caméra, c’est le signe d’une catastrophe !" Un précepte que devrait méditer Scrat, l’écureuil débile de l’Age de Glace. Dans un rôle plus proche du pince-sans-rire que du casse-noisettes, on retrouve Ollivier Pourriol, le philosophe des longs-métrages. Aujourd’hui : "Les Images de la Catastrophe", pour se faire peur, pour y croire, et pour y échapper…en vrai !
Après avoir décortiqué les effets du cinéma sur le psychisme du spectateur Ollivier Pourriol, le dandy cinéphage au look hyper-normal illustre sa théorie à partir des films catastrophes et parfois annonciateurs de réalités. Titanic et Le Jour d’Après, Blade Runner et l’Age de Glace : quatre films qui ont à voir avec la catastrophe, les deux premiers parce qu’ils l’annoncent et la font vivre, les deux seconds parce qu’il se déroulent en des temps quelque peu apocalyptiques.
Cinéma de masse et de messe
On entre dans le sujet par des définitions qui constituent le générique.
D’abord, le cinéma a la propriété de créer des souvenirs communs à toute une communauté ; le cinéma de masse (les blockbusters) en a presque la vocation, associée à celle d’inspirer le sentiment d’une communion sociale, idéologique, culturelle, communautaire. Le blockbuster est donc le résultat d’une équation pernicieuse entre course aux profits, flatterie des pulsions individuelles et projection des fantasmes collectifs.
Le cinéma de masse a presque pour vocation (…) d’inspirer le sentiment d’une communion sociale, idéologique, culturelle
Ensuite une vérité : les spectateurs ordinaires, ces semi-experts du cinéma [1] n’affrontent pas, dans leurs existences, de bouleversement violent. En contrepartie, les films racontant des cataclysme individuels et collectifs les habituent à un sentiment mêlé de dégoût et de délectation.
L’emprise sur l’imaginaire
Il apparaît de plus que ces pulsions et fantasmes sont rejoints par une sorte de didactisme, recherché par les auteurs. A l’époque médiévale, la morale chrétienne s’incarnait dans des mystères édifiants ou la terreur de l’Enfer ; à lors actuel , le cinéma, cette technologie de l’imaginaire, est le moyen le plus efficace de rendre perceptibles ces peurs ancestrales dans leurs variations modernes.
Et Pourriol de citer Michel Foucault : "Pour exercer un pouvoir coercitif symbolique basé sur la crainte, il faut créer le spectaculaire de la punition (c’est-à-dire, jusqu’à peu, le châtiment public)" [2]. …et Michel Foucault de citer Joseph-Michel Servan : " Pour être maître des hommes, il faut être maître de leur imagination. ". Bref : la nouvelle crainte millénariste s’incarne à merveille dans le 7°art.
Pas de comète cataclysmique ou de jugement dernier au programme des multiplex, mais parfois une vraie catastrophe mondiale !
Spectateur du naufrage des temps apocalyptiques
Précision préliminaire bien pratique : en grec l’apocalypse (apo-kalupsis), c’est le lever du rideau de théâtre ; dans la tradition chrétienne, c’est la révélation de la vérité décisive ; dans le vocabulaire moderne, c’est la catastrophe ultime. Trois sens successifs que le Film-Catastrophe rassemble simultanément sur un même écran. [3].
Pourtant, il ne s’agit pas de susciter la terreur, juste le frisson. Illustration : l’Age de Glace et l’amorce du Jour d’après offrent une vue aérienne sur une banquise qui se fissure soudainement, amorçant le cataclysme global. Le regard du spectateur se voit offrir un point de vue suffisamment global pour s’en sentir le maître, suffisamment proche pour en frémir. Citant une nouvelle fois Lucrèce qui développait l’idée que l’on ressent une étrange satisfaction à assister à un naufrage dont on serait le témoin impuissant, Pourriol explique que le public se sent ainsi sauvé et déresponsabilisé. Une satisfaction narcissique de l’inconscient collectif, donc.
Les vertus du naufrage ou La catastrophe fait la révolution
Les scénarios de l’après-catastrophe sont parfois l’occasion de renversements ethniques, sociaux, moraux, environnementaux qui s’étendent de l’inquiétante étrangeté -comme dans La Planète des Singes-, à l’inquiétante familiarité –comme dans Minority Report.
Historique, Titanic propose un mouvement plus général de résolution des inégalités, en effectuant un nivellement par le bas : sur le pont de l’insubmersible, Rose regimbe contre l’autorité phallocratie incarné par son fiancé tandis que les poulbots s’apprêtent à tout briser pour sauver leurs vies. Dans d’autres cas, le film traduit une recomposition des équilibres sociaux, parfois vers le pire (Mad Max), parfois en l’idéalisant, ou en renversant les valeurs, comme quand les autorités mexicaines accordent l’asile aux vagues de réfugiés Etats-Uniens (Le Jour d’Après). Parmi toutes ses propriétés, le cinéma a celle de se faire prophète d’une apocalypse possible.
Gore, mais surtout pas saignant
Une vérité qui dérange le docu de Al Gore s’est imposé comme l’archétype du documentaire catastrophe. En profitant de la crainte millénaire ancestrale, il annonce une apocalypse possible, sur des bases scientifiques probantes. Pour emporter la raison, ce docu joue inévitablement avec une fibre émotionnelle à la frontière de l’inquiétant et de la complicité. Les niveaux de montages s’enchevêtrent : des données scientifiques inquiétantes présentées lors de conférences médiatisée devant un public captivé, lui-même filmé, sont remontées avec des plans de coupe montrant un Al Gore tout entier consacré à sa mission.
La violence permise par la fiction s’efface dès lors que le propos devient réaliste ; c’est pourquoi, dans le documentaire, le seuil de la sensibilité est aussi rapidement franchi que celui du politiquement correct. Un changement rhétorique est alors nécessaire : le discours s’appuie sur des métaphores et non plus des représentations.
Les mythes, les mystères médiévaux et autres processions édifiantes ont laissé la place à la mise en scène de cinéma. L’histoire apocalyptique moderne (...) s’appuie davantage sur la science
Quand la violence sensorielle est proscrite, remplacée par une batterie d’arguments triés sur le volet. Certains mettent en balance la menace écologique et terrorisme, et ce sur des bases auxquelles le public serait sensible, à savoir l’aspect…financier. Une autre fois, devant la banalisation du nombre de victime , c’est une injustice topographique qui est annoncée : "il faudra refaire les cartes". Et puis, pour ne pas trop soulever les cœurs et éviter que la salle ne se vide, toute représentation de l’espèce humaine en détresse est évitée. L’humain est symbolisée par l’ours polaire, devenu désormais le symbole animal d’une mort individuelle. L’anthropomorphie est encore trop forte : en situation critique, c’est à une grenouille hilare et virtuelle à qui il revient de jouer le rôle du plantigrade.
Le cinéma catastrophe pourrait-il l’éviter l’apocalypse ?
On l’a vu : les représentations théâtrales des mythes, les mystères médiévaux et autres processions édifiantes laissent aujourd’hui la place à la mise en scène cinématographique. L’histoire apocalyptique moderne est désormais soumise au doute, mais elle s’appuie d’autant plus fermement sur la science et l’argumentation.
Cependant, le cinéma grand-public jongle avec des paradigmes douteux : gain, rentabilité, politiquement correct, sensationnalisme et communication de masse. Paradoxalement, la chose a des bons côtés. Ces apocalypses fictives ou fictionnalisées induisent pour certaines un accroissement de la conscience du drame global écologique qui se noue. Edifiant !
Renaud CERTIN
Pourriol dans Fragil :
Il faut filmer le soldat Ryan : Conférence et interview, Rencontres de Sophie 2007
L’Effet de Serres : rencontre autour du Mal propre de Michel Serres (2008)
Pourriol sur la toile :
Le programme du ciné-philo, à Paris.
Pour faire le tour de tous les thèmes traités (De l’Age de Glace aux Affranchis) et des confs : un myspace et un blog.
Pourriol version papier :
Cinéphilo : Les plus belles question de la philosophie sur grand écran.
Alain, le grand voleur : Essai sur Émile-Auguste Chartier aka Alain.
Hubert Grenier : Essai sensible sur la pédagogie et l’enseignement.
Mephisto Valse (Roman) : La jeune Fille et la Mort, version masculine pour piano solo.
Le Peintre au Couteau (Roman) : littérature, art plastique et chirurgie du même acabit.
Polaroïde (Roman) : polar bizarroïde en forme de grosse pomme rhizomique.
[1] L’expression est de Walter Benjamin, dans L’œuvre d’art à l’âge de sa reproductibilité technique.
[2] Selon Foucault, la menace opère selon trois degrés, de moins en moins vécu physiquement par le sujet, mais de plus en plus efficacement représentée dans l’esprit du plus grand nombre.
[3] Le mot Apocalypse vient du grec ancien et à prit trois sens successifs. Imaginer une scène de théâtre grec, en extérieur ; il y a donc bien un rideau, mais qui, en réalité, tombe par terre au début de la pièce. Le théâtre du cinquième siècle avant JC sacralise la vérité de la vie humaine, toujours sous le patronage d’une divinité -en général Dionysos- ce qui implique que, quand le rideau tombe, la vérité du sacré soit dévoilée. Voilà qui crée le premier sens d’Apocalyse. Ensuite, dans la tradition judéo-chrétienne, le mot prendra le sens de révélation finale de la vérité. C’est par glissement à partir de l’idée du dernier jour de l’humanité, et de la catastrophe qui y est associée, qu’est apparu le sens actuel du mot.
Bloc-Notes
-
«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013
-
Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers
-
La 7ème Vague ouvre le bal des festivals
-
Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois
-
Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses


 Le dernier numéro
Le dernier numéro






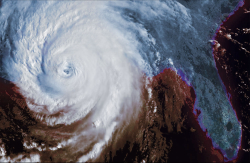
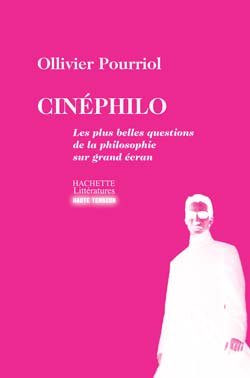
 Haut de la page
Haut de la page




